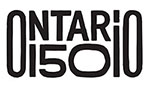Oksana Kravets, Toronto

Il y a des gens qui s’arrêtent pour respirer le parfum des roses. Certains se réveillent de bonne heure pour assister au lever du soleil. Mon père guette les orages.
Petite fille, je le voyais se lever aux premiers grondements du tonnerre, baisser le son de la télé et se placer devant la fenêtre. Parfois, je le rejoignais lorsque les nuages s’assombrissaient et que la pluie tambourinait ses premières notes. Les éclairs commençaient et nous comptions les secondes entre le tonnerre et l’éclair qui lui faisait suite, lisant chacun des orages comme une histoire, du début à la fin.
Cette tradition que nous avons implicitement instaurée m’a laissé un amour durable du mauvais temps. Au cours des derniers mois, j’ai fait une promenade de 10 km dans une tempête de neige et j’ai marché avec obstination sous les averses d’avril alors que j’aurais pu prendre le métro. La transformation des espaces par les tempêtes me fascine, depuis le quartier que le blizzard efface à moitié jusqu’à la tranquillité surréaliste lorsque les foules du centre-ville se mettent à l’abri de trombes d’eau à l’intérieur des édifices. Par mauvais temps, l’endroit le plus banal peut donner l’impression que la première scène d’une histoire captivante s’y déroule. Le mauvais temps m’offre une image plus complète de ma ville et, en faisant le vide, la possibilité de l’explorer à mon propre rythme.
Ces photos ont été prises pendant une tempête de verglas cette année. À 22 h, la bruine n’était plus qu’un murmure, qu’il était surprenant d’entendre dans les rues désertes. Chacun des réverbères jetait un halo, et les toiles de branches vitreuses réfléchissaient et amplifiaient la lueur. Je n’avais jamais vu Toronto briller autant par une nuit de février.
Thèmes de cette histoire
Photo Gallery
-

Crédit : Oksana KravetsToronto pendant une tempête de verglas (2017) -

Crédit : Oksana KravetsToronto pendant une tempête de verglas (2017)
Thèmes les plus regardés